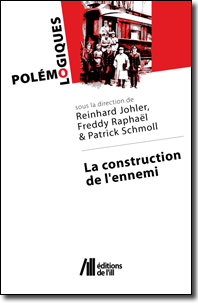Entretien avec Pascal Hintermeyer,
Professeur de sociologie à l’Université de Strasbourg
aaaa
Éditions de l’Ill – Les Éditions de l’Ill reprennent la collection « Polémo-logiques », que vous avez dirigée pendant dix ans aux éditions Néothèque. Quel est le projet de cette collection ?
Pascal Hintermeyer – Il reste ce qu’il était au départ en 2007, à l’époque où l’Institut de Polémologie de Strasbourg relançait les études sur le conflit. Il s’agit d’accueillir des textes qui approchent les faits sociaux en accordant aux processus conflictuels une valence positive. C’est l’originalité de la ligne éditoriale de cette collection dans ce champ d’études. Les conflits, y compris violents, n’y sont pas pensés comme une pathologie du social, mais comme une des formes dans, et par laquelle, le social se construit. La collection renouvelle en cela une tradition inaugurée par Gaston Bouthoul, qui avait proposé le terme de « polémologie » dans cette perspective. À Strasbourg, ce courant a été prolongé, dans les années 1970 et 1980, par les travaux de Julien Freund qui y fonda l’Institut de Polémologie.
« La polémologie ne pense pas les conflits comme une pathologie du social, mais comme une des formes dans, et par laquelle, le social se construit »
L’Ill – Ce sont des auteurs qui ont été un peu oubliés. Peu d’auteurs se sont réclamés de la polémologie dans les décennies qui ont suivi leur disparition. Qu’est-ce qui redonne son actualité à ce mode d’approche ? Est-ce qu’il y a vraiment une place pour une telle collection dans les débats de société contemporains ?
PH – Paradoxalement, ce sont les transformations des régimes de la conflictualité qui confèrent une nouvelle pertinence à l’approche polémologique. Effectivement, les travaux de Bouthoul et Freund prennent place dans un contexte historique qui est celui de l’après-Seconde Guerre mondiale, avec un monde fortement bipolarisé entre l’Est et l’Ouest. La crainte d’une Troisième Guerre mondiale dégénérant en apocalypse nucléaire justifie à l’époque les travaux qui se penchent sur les processus conflictuels, pour les comprendre et les prévenir. Quand le bloc soviétique se dissout, à la fin des années 1980, et que le modèle capitaliste se mondialise, les guerres ne disparaissent pas, mais elles se dispersent, deviennent locales, et aucune ne peut servir de boutefeu d’un brasier généralisé. Entre qui et qui, d’ailleurs ? La polémologie tombe un peu dans l’oubli. C’est pourtant dans notre monde devenu multipolaire et instable que se renouvelle l’approche polémologique, parce que les conflits sont devenus multiples, mobiles et insaisissables. Du moins nous en avons l’impression parce que leur fait défaut cette organisation duelle du monde qui permettait leur récupération et leur expression à haut niveau. De ce fait, ils restent dispersés et variables. Il faut donc renouveler aussi nos lectures de ces processus.
L’Ill – La collection reprend en commençant par une réédition de La construction de l’ennemi et par un ajout à la collection : la mise en ligne de L’art de la guerre, de Sun Tzu. Est-ce un choix ? Les deux ouvrages se répondent-ils l’un l’autre ?
PH – Oui, c’est un choix : nous n’avons pas commencé la réédition des ouvrages de la collection dans l’ordre qui a été celui de leur publication originale. Nous avons réfléchi à ce qui nous paraissait le plus intéressant parce que porteur de réflexions innovantes. L’art de la guerre n’est certes pas un traité nouveau, loin de là, puisque c’est le premier ouvrage de stratégie militaire de l’Histoire, et que, par surcroît, il en existe des traductions récentes et rigoureuses chez d’autres éditeurs. Mais la perspective, ici, n’est pas celle du philologue ou du sinologue. La mise en ligne de cette version invite surtout à une relecture de Sun Tzu. La préface de Patrick Schmoll souligne l’actualité du penseur chinois à l’ère de la complexité et des réseaux. Et c’est en particulier la conception de l’ennemi chez Sun Tzu qui invite à relire ce dernier : en quoi il fait écho à l’ouvrage collectif que nous rééditons, qui traite justement de cette figure de l’ennemi dans ses avatars contemporains.
L’Ill – L’Allemagne, puis le bloc de l’Est hier, la Chine ou le terrorisme religieux aujourd’hui : l’ennemi change de tête, mais il y a toujours un ennemi.
PH – Il ne fait pas que changer de tête, aujourd’hui. Ce n’est pas seulement que de nouveaux ennemis ont remplacé les anciens, ni même qu’ils deviennent plus difficiles à identifier parce que multiples et insaisissables. C’est la solidité même de cette figure de l’ennemi, qui est ébranlée. On n’arrive plus à retrouver la fonction rassurante de l’Ennemi, unique objet de nos peurs et de nos haines, qui hante notre manière de penser romano-chrétienne. C’est un processus qui a été enclenché au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par le rapprochement des ex-belligérants et la construction européenne. Les ennemis « héréditaires » d’hier, qui s’affrontaient depuis des siècles, sont devenus en moins de deux décennies les partenaires d’aujourd’hui. Quand on veut bien s’y arrêter, ce retournement était inouï, impensable pour les générations qui avaient vécu la guerre. Il a de quoi nous faire méditer sur la construction des inimitiés. Quoi ? On nous a présenté l’Allemand comme la menace immonde à abattre, et on y a perdu des amis et des parents, morts au combat, en détention ou exécutés ; et maintenant on se sert la main et on fait les courses du week-end les uns chez les autres ?
L’Ill – Il y a donc de quoi nous faire hésiter, quand aujourd’hui on propose à notre assentiment de nouvelles figures hostiles, qu’elles soient ethniques, religieuses, terroristes, ou incarnées par un « État-voyou ». Il s’agit donc d’interroger la consistance de ces ennemis ?
« Il faut reconsidérer l’ennemi, non pas comme allant de soi, mais comme un construit »
PH – L’idée-force, c’est effectivement de reconsidérer l’ennemi, non pas comme allant de soi, mais comme un construit. Ce qui revient à se demander à quoi sert ce construit. On se rend compte, alors, que l’ennemi n’apparaît pas au-devant d’un collectif déjà-là, qu’il se mettrait à menacer. Souvent, c’est l’ennemi qui est premier, et c’est lui qui, en focalisant les représentations et l’action, précipite l’unité du groupe, voire contribue à le fonder. Le politique se sert, bien entendu, de cette figure pour mobiliser le collectif. Ce fut le cas de la Guerre franco-prussienne de 1870, qui a servi à réaliser l’unité allemande. C’est une idée qui est présente en politologie et en sociologie, chez Carl Schmitt et Julien Freund, mais aussi dans notre construction psychologique, si l’on se réfère à Freud et Mélanie Klein, par exemple : c’est parce que l’autre est constitué primitivement en mauvais objet, que le moi peut se construire en introjectant le bon pour se protéger de sa propre violence.
L’Ill – Mais les ennemis existent, tout de même ! Il y a des gens qui nous veulent du mal, des peuples qui se font vraiment la guerre et s’entretuent. Ce ne sont pas que des projections de notre part.
PH – Il y a sans doute des gens qui nous veulent du mal, parce qu’ils projettent sur nous, comme nous sur eux. C’est cette interaction qui contribue à la solidité de la figure, et comme elle est archaïque, elle n’est pas suffisamment interrogée. Elle passe pour une donnée naturelle. C’est un point aveugle de la pensée stratégique, et en fait, de la pensée tout court. Bien sûr que les ennemis existent, mais si l’on oublie que nous nous les fabriquons à notre main, pour nous rassurer sur le fait que nous sommes du bon côté, il devient difficile de traiter avec eux. Nous restons dans un cadre de pensée où la stratégie consiste seulement à réunir les moyens de les écraser ou de les faire disparaître.
L’Ill – On en revient à Sun Tzu, en ce que son approche diffère de celle de nos penseurs stratégiques, Clausewitz notamment.
PH – Il ne faut pas faire porter par Clausewitz davantage qu’il n’a écrit, c’est seulement qu’il a fini par devenir l’emblème d’un mode de penser qui est, beaucoup plus profondément, notre héritage culturel romano-chrétien. Depuis deux mille ans, le politique, et donc le stratégique, mais aussi jusqu’à notre psychologie, se pensent dans les termes d’un empire ceinturé par des défenses. À l’intérieur, la civilisation, à l’extérieur la sauvagerie et le chaos, qu’il faut conquérir ou détruire. La Chine ancienne ne se pensait pas ainsi, parce que, pendant longtemps, elle a été protégée de l’extérieur par des espaces naturels : océans, chaînes montagneuses, déserts. L’ennemi était éloigné et peu nombreux, ses agressions étaient peu cohésives. Les guerres se déroulaient surtout entre Chinois eux-mêmes. De sorte que l’adversaire n’était pas un ennemi étranger qu’il s’agissait d’asservir ou d’éliminer, mais un possible futur sujet de l’empereur, qu’il fallait préserver autant qu’il se pouvait, puisque ses richesses seraient un jour celles de l’empire.
« Relire Sun Tzu permet de souligner l’actualité du penseur chinois à l’ère de la complexité et des réseaux »
L’Ill – On est donc en présence d’une conception très différente de l’ennemi.
PH – Il serait plus juste de parler d’adversaire que d’ennemi, en effet. Et c’est une conception qui s’avère ainsi très adaptée à la nouvelle configuration du monde, et à l’évolution de nos psychologies. Nous ne vivons plus dans un monde dominé par les relations duelles entre un centre et une périphérie, ou entre deux blocs, mais dans un monde multicentré, complexe, interdépendant, et surtout, sans bords : nous vivons tous dedans. L’autre y est à la fois un adversaire et un alter-ego. Si l’on veut en faire un ennemi, c’est alors un ennemi intérieur, et l’on sait à quelles extrémités peut conduire cette manière de penser.